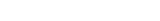Où voyageons-nous?
Le voyage est devenu naturel pour nous. Les destinations lointaines sont-elles la finalité du voyage? C’est ce que demande l’auteur Charles Lewinsky.
Si nous prenons la littérature mondiale comme reflet de la réalité et que nous examinons de plus près les histoires de mobilité classiques, il semble que la finalité des voyages qui y sont dépeints soit une destination lointaine. En y regardant de plus près, c’est en fait l’inverse: les protagonistes ne partent pour des contrées inconnues que pour pouvoir rentrer chez eux. Les grands poètes de l’Antiquité l’avaient déjà compris: Homère n’a fait vivre son Odyssée à Ulysse dans la totalité du monde connu alors que pour lui permettre de rentrer au calme à Ithaque auprès de sa femme Pénélope au bout de dix années d’aventure. Jason et ses Argonautes n’ont quant à eux entrepris leur expédition pour la Toison d’or que pour pouvoir rapporter leur trophée chez eux après d’innombrables exploits. En faisant un bond de quelques siècles, on constate que rien n’a changé: Gulliver de Jonathan Swift et Robinson de Daniel Defoe ne visitent les régions les plus reculées que pour en parler à la fin lorsqu’ils sont de retour chez eux. Même la littérature pour enfants confirme ce schéma: Heidi n’est heureuse que lorsqu’elle peut rentrer dans ses montagnes et Fifi Brindacier revient aussi du pays Taka-Tuka dans sa familière villa Drôlederepos.
Toutes ces histoires (et on pourrait en citer des centaines d’autres) reposent sur l’énoncé suivant: l’objectif final de tout voyage est le retour au point de départ. Ou en d’autres termes:
Pour pouvoir profiter des découvertes et des émotions liées à la mobilité, nous devons avoir la certitude de pouvoir, si nous le souhaitons, y mettre un terme à tout moment. Tant que nous n’oublions pas d’où nous venons et que nous avons l’intime conviction que le chemin du retour ne nous est pas interdit pour toujours, nous sommes libres de découvrir le monde.
Si nous sommes privés de cette certitude (même si l’impossibilité de retourner au point de départ de notre voyage n’est qu’imaginaire), nous souffrons de «morbus helveticus», comme on l’appelait au 18e siècle. Comprenez: le mal du pays. Les mercenaires suisses à l’étranger auraient été si vulnérables qu’ils n’avaient même pas besoin d’être trop éloignés de leur patrie pour devenir déserteurs en entendant le «Ranz des vaches». L’Alsace pouvait déjà être trop éloignée de la mère patrie, comme le décrit la chanson populaire d’un déserteur souffrant du mal du pays: «A Strasbourg, sur le rempart, c’est là que mon malheur a commencé.»
Le fait que l’on puisse être frappé par le mal du pays comme par un virus ne signifie toutefois pas que la mobilité, c’est-à-dire l’état d’être en déplacement ou ailleurs, soit forcément négative. Si la soif d’aventure et le plaisir de la découverte n’étaient pas fortement ancrés dans nos gênes, l’humanité n’aurait jamais quitté les steppes d’Afrique, personne n’essaierait de donner une nouvelle tournure à sa vie dans un autre pays et les vols pour les Maldives ne seraient pas complets. Mais nous savons aussi qu’il y a toujours un avion pour nous ramener rapidement en Suisse.
Et un autre élément fait que la nostalgie pour son environnement familier ne se manifeste plus comme une maladie virulente, mais au maximum comme un mal-être psychique inoffensif: les différentes régions du globe se ressemblent de plus en plus. Bien sûr, les Australiens seront toujours plus conviviaux que les Suisses, les Israéliens moins polis et les Italiens plus chaotiques. Mais dans le monde entier, le même Starbucks vend le même Venti Latte au lait de soja et à la vanille et les mêmes boutiques sont seulement alignées dans un ordre différent, quel que soit le centre commercial que nous parcourons ou la rue commerçante que nous arpentons. Nous avons l’impression d’être incroyablement mobiles, mais nous avons souvent fait en sorte qu’ailleurs ressemble de plus en plus à chez nous.
Si Circé avait chanté les mêmes chansons que celles du hit-parade d’Ithaque, Ulysse n’aurait pas eu besoin de se boucher les oreilles, il aurait pu jeter l’ancre et danser en rythme. Gulliver serait resté chez les Lilliputiens s’il y avait trouvé un supermarché avec ses céréales préférées. Seule la minuscule taille des paquets l’aurait peut-être dérangé. Et Fifi Brindacier serait toujours au pays Taka-Tuka si la télévision locale y diffusait les mêmes séries pour enfants qu’elle aimait tant regarder à la villa Drôlederepos.
Plus il est naturel pour nous d’être mobiles dans le monde entier, plus il est difficile de vivre réellement la mobilité. Car si ce mot doit avoir un sens, il ne se contente pas de désigner un simple changement de lieu. Il doit aussi inclure la volonté de s’intégrer dans un environnement différent. S’il est identique partout, nous n’avons pas de raison de revenir chez nous à un moment. Un domicile qui existe partout n’en est plus un.